Votre terrain est-il éligible à un projet photovoltaïque ?
- 31 juil. 2025
- 17 min de lecture
Dernière mise à jour : 26 sept. 2025
Vous êtes propriétaire d’un terrain et vous vous demandez s’il pourrait accueillir une centrale photovoltaïque au sol ? C’est une question de plus en plus fréquente — et pour cause : face à la montée des prix de l’énergie les projets solaires connaissent un véritable essor.
Pour un propriétaire, l’intérêt est évident : la valorisation d’un foncier parfois peu utilisé, loyers sécurisés sur le long terme, voire dans certains cas, la satisfaction de participer à un projet agricole double usage (agrivoltaïsme). Mais avant d'envisager un projet solaire, encore faut-il répondre à la question essentielle : Votre terrain est-il réellement éligible à un projet photovoltaïque ?
La plupart des candidats ont entendu cette idée simple : “il suffit d’un hectare et de soleil”. Dans les faits, aucun développeur sérieux ne s’engage sans avoir croisé une multitude de critères techniques, réglementaires, environnementaux et surtout économiques. La réalité, c’est que la faisabilité d’un projet photovoltaïque au sol ne dépend jamais d’un critère unique, mais toujours d’un faisceau de conditions à réunir, à analyser, à anticiper.
Par exemple, un terrain de grande taille peut se révéler inexploitable s’il est en zone protégée, mal desservi, ou trop éloigné d’un poste source. À l’inverse, une petite parcelle bien placée, sur un zonage compatible, avec un raccordement possible et une pression environnementale faible, peut devenir très attractive. Ce sont ces équilibres que les développeurs évaluent, parfois même avant de prendre contact avec un propriétaire.
C’est précisément là que Solaire Conseil intervient. Notre mission est de vous accompagner dans cette première étape critique : vérifier objectivement si votre terrain rempli suffisamment de conditions pour susciter l’intérêt d’un développeur. Un terrain n’est jamais évident ou incompatible à première vue.
Dans cet article, nous allons passer en revue les 5 grands axes de faisabilité qui permettent de se faire une idée précise du potentiel photovoltaïque d’un terrain.

La faisabilité économique, première grille de lecture
Quand un développeur photovoltaïque reçoit un terrain, il commence par une question simple : est-ce que ce terrain a une chance raisonnable de déboucher sur un projet rentable ? Il cherche à estimer si, oui ou non, le jeu en vaut la chandelle.
Dans les faits, la toute première étape de sélection passe par une estimation rapide de la faisabilité économique, c’est-à-dire la capacité du site à générer un projet qui produira de l’électricité à un coût compétitif, dans des délais acceptables, et avec un risque réglementaire maîtrisé.
Cette estimation repose sur quelques variables clés : surface exploitable, raccordement possible, zonage favorable, contraintes environnementales, accessibilité, usage actuel du sol.
Le développeur modélise ensuite un business plan simplifié, qui lui permet d’estimer un TRI (taux de rentabilité interne) prévisionnel. Cet indicateur, c’est son phare :
si le TRI estimé est bon, il avancera vite
s’il est limite, il surveillera mais investira moins d’énergie
si le TRI est insuffisant, il ne donnera pas suite
Le TRI, un indicateur synthétique mais dépendant de tous les autres
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que ce TRI économique n’est pas un critère isolé. Il résume, en réalité, l’impact cumulé de tous les autres paramètres du projet : taille et forme du terrain, distance au poste source, type de sol, contraintes environnementales, acceptabilité locale, etc.
Notre avis d'expert Un terrain n’est pas “bon ou mauvais” en soi. Il peut devenir économiquement attractif grâce à un bon raccordement, à une absence de contraintes, ou à une configuration foncière simple. À l’inverse, un très beau site peut devenir non rentable si le raccordement est trop coûteux ou si les délais réglementaires s’allongent. |
Le “filtre” économique est mobile
Si votre terrain n’est pas retenu après cette première analyse économique, cela ne signifie ni qu’il est inutile, ni qu’il est définitivement écarté à jamais. Cela signifie simplement qu’au moment de l'analyse, le ratio “effort à fournir / chance de succès” n’est pas encore assez favorable pour qu’un développeur y consacre du temps et des moyens.
C’est un arbitrage rationnel, pas un jugement de valeur sur le terrain lui-même. Un projet qui semble limite aujourd’hui peut devenir intéressant en fonction de l'évolution des législations, du marché ou du réseau électrique. Les développeurs raisonnent en dynamique, pas en photo figée.
Un autre élément à garder en tête : chaque développeur a sa propre lecture du TRI acceptable. Certains sont très sélectifs, d’autres plus ouverts à des projets à maturité longue. Certains ont accès à des coûts de financement plus bas, ou à des filières de valorisation spécifiques. Cela signifie que ce qui est jugé “faible potentiel” par un acteur peut être perçu comme “stratégique” par un autre.
Pour le propriétaire, cela renforce l’intérêt d’un pré-diagnostic neutre : un regard indépendant permet de savoir si le terrain franchit la première marche économique, et dans quelles conditions il pourrait devenir réellement attractif.
Terrain, topographie, accès : ce que votre parcelle dit du projet

Après le premier filtre économique, le développeur passe rapidement à l’analyse “terrain” proprement dite. Il ne s’agit pas seulement de savoir si la surface est disponible, mais si elle est réellement exploitable, accessible, réglementairement compatible et techniquement réalisable.
Cette étape permet d’éliminer certains sites trop complexes ou d’identifier les conditions à réunir pour les rendre acceptables. Elle repose sur un petit nombre de facteurs concrets mais souvent décisifs.
Une surface continue, bien découpée, sans servitudes bloquantes
Un projet photovoltaïque au sol demande une emprise importante, mais surtout une surface continue. La taille minimale souvent citée est 1 hectare, mais elle ne suffit jamais à elle seule. Ce qui compte, c’est la configuration réelle du terrain :
sa continuité physique (pas de coupures par des haies, fossés, chemins ou servitudes diverses),
sa forme (les parcelles carrées ou rectangulaires sont privilégiées pour optimiser l’implantation des rangées),
l’absence de servitudes bloquantes (lignes, canalisations, chemins ruraux non déplaçables…).
Notre avis d'expert “J’ai 5 hectares, cette surface est suffisante.” Pas forcément. Si ces 5 hectares sont morcelés en trois parcelles non contiguës ou traversées par des contraintes physiques, ils peuvent devenir moins intéressant qu'un terrain de 2 ou 3 hectares. |
Une topographie adaptée à la production et aux travaux
La pente et l’orientation du terrain jouent un rôle majeur dans la faisabilité technique. Une pente douce orientée au sud(ou sud-est / sud-ouest) est idéale, car elle permet une bonne exposition au soleil et limite les travaux de terrassement.
À l’inverse, une pente trop marquée nécessitera des travaux de nivellement coûteux, voire une réduction de densité des panneaux, ce qui affecte la productivité du site.
Les développeurs examinent aussi la présence de “masques solaires” : ombrages dus à des haies, bois, talus, bâtiments ou reliefs proches. Ces ombres peuvent réduire significativement la production, et donc le TRI.
Enfin, les plans de prévention des risques (PPR) — inondations, feux de forêt, mouvements de terrain — sont également intégrés dans l’analyse. Ils peuvent :
imposer des études supplémentaires,
entraîner des délais d’instruction,
ou même interdire totalement la construction sur certaines zones.
Des sols praticables, porteurs et réglementairement acceptables
Souvent sous-estimée par les propriétaires, la nature du sol est pourtant cruciale. Un sol stable, peu sensible aux mouvements, non gorgé d’eau, facilite les fondations simples et évite des ancrages lourds ou complexes.
À l’inverse, les terrains identifiés comme zones humides au sens de la loi sur l’eau nécessitent des études géotechniques, hydrologiques avec à la clé des coûts et des incertitudes supplémentaires.
Les zones humides représentent un double enjeu : environnemental (présence de faune ou flore protégée) et technique (sols peu porteurs, chantiers difficiles). Elles doivent en général être évitées ou faire l’objet de compensations.
La présence de boisés : contrainte physique et sensible politiquement
De nombreuses parcelles marginales ou en friche sont partiellement boisées. Cela constitue souvent un frein majeur, pour deux raisons :
Technique et réglementaire : la coupe d’arbres nécessite des autorisations spécifiques (autorisation de défrichement, étude d’incidences environnementales), parfois des mesures compensatoires.
Acceptabilité locale : un projet impliquant la suppression de zones boisées peut susciter une opposition forte, même s’il est techniquement recevable.

Cas 3 de la CRE : les terrains de moindre enjeu foncier, très recherchés

La Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) a mis en place une catégorisation des terrains dans ses appels d’offres pour obtenir un contrat de complément de rémunération (AO PPE2). Parmi ces catégories figure le “cas 3”, aussi appelé terrain à “moindre enjeu foncier”.
Ces terrains sont explicitement favorisés par la CRE, car ils permettent d’implanter des projets sans conflit d’usage, avec un impact foncier réduit. Il s’agit notamment de :
friches industrielles, militaires ou logistiques désaffectées,
anciennes carrières ou décharges,
zones artificialisées, emprises routières inutilisées,
plans d'eau
Être classé “cas 3” est un atout compétitif majeur.
Cela améliore la note du projet dans le cadre de l’appel d’offres national (AO), ce qui augmente fortement ses chances d’être lauréat. Concrètement, cela signifie que les développeurs ciblent en priorité ce type de foncier. Un terrain, même techniquement moyen, peut ainsi devenir stratégique s’il entre dans cette catégorie. Pour en savoir plus sur les terrains de moindre enjeu foncier, consultez notre article sur le sujet.
Zonages, règles d’urbanisme et contraintes environnementales : ce que dit le territoire

Même un terrain bien orienté, accessible, plat, et d’apparence libre peut être bloqué par une ligne dans un document administratif. L’analyse réglementaire est donc une étape décisive. Elle détermine si un projet peut s’intégrer dans le cadre juridique et territorial local — ou, au contraire, s’il risque d’entrer en conflit avec des protections, des usages prioritaires, ou des règles d’urbanisme contraignantes.
Un projet photovoltaïque doit être compatible avec les documents d’urbanisme, les servitudes existantes, les contraintes environnementales, et de plus en plus, les objectifs locaux de planification énergétique. Voici les principales dimensions examinées par les développeurs.
Le PLU ou carte communale : une première lecture obligatoire
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), ou à défaut la carte communale, constitue la première source d’information. C’est lui qui dicte l’usage autorisé du sol. Selon le zonage, la faisabilité du projet change du tout au tout :
Zone U (urbaine) : en général, les projets au sol y sont exclus. Seules certaines friches peuvent faire exception.
Zone A (agricole) : c’est un cas courant, mais soumis à des règles strictes. Un projet y est envisageable essentiellement dans le cadre de l’agrivoltaïsme, et avec l’accord des instances agricoles.
Zone N (naturelle) : possible, mais très encadrée. Il faut démontrer l’intérêt du projet, ses bénéfices locaux, et surtout son intégration dans l’environnement.
Zone AU (à urbaniser) : parfois favorable, mais attention : ces terrains sont souvent réservés pour de futurs logements, équipements ou zones d’activité. Le photovoltaïque n’est pas toujours compatible avec les objectifs de développement fixés par la commune.
Outre le zonage, chaque PLU comporte un règlement écrit qui précise, ce qui est autorisé ou interdit pour chaque zonage : taille maximale d’un projet, conditions d’intégration paysagère, etc.
Dans certains cas, un terrain pourrait théoriquement accueillir un projet solaire mais le PLU l’interdit explicitement. À l’inverse, d'autres PLU l'autorisent sous certaines conditions. Il n’y a aucune règle nationale uniforme : chaque commune décide de son propre cadre.
Peut-on modifier un PLU pour autoriser un projet ? Oui, mais c’est long et complexe. Cela implique une procédure de modification ou révision. Les développeurs n'y recourent que pour des projets très solides, avec un fort soutien local.
Zones d’accélération des énergies renouvelables (ZAER) : un signal politique fort, mais pas une autorisation

La loi APER, adoptée en 2023, a introduit un nouvel outil : les zones d’accélération des énergies renouvelables (ZAER). Ces zones sont proposées par les communes, puis validées par l'État, pour identifier les secteurs jugés “favorables” à l’implantation de projets d’ENR.
Être en ZAER présente plusieurs avantages :
cela accélère les délais d’instruction,
limite les consultations administratives,
et signale la volonté politique locale d’accueillir un projet.
Notre avis d'expert Une ZAER n’est pas un passe-droit. C’est un levier de fluidification, pas une validation automatique. Elle ne remplace pas le PLU, n’annule pas les contraintes environnementales, et ne garantit pas l’obtention du permis. Un terrain situé en ZAER reste soumis à toutes les autres règles : zonage, biodiversité, raccordement… |
Espaces protégés, biodiversité et zones sensibles
La dimension environnementale est l’un des piliers de l’analyse de faisabilité. Un projet peut se heurter à des protections fortes dès lors qu’il est situé :
dans un site Natura 2000 (réseau européen de préservation de la biodiversité),
dans une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique),
en zone humide reconnue,
dans une trame verte ou bleue (corridors écologiques identifiés dans les documents régionaux),
ou à proximité d’espèces protégées (faune, flore, habitats spécifiques).
La présence dans l’une de ces zones n’interdit pas systématiquement un projet, mais elle entraîne des conséquences importantes : évaluation d’incidences, études d’impact poussées, demandes de dérogation, mesures de compensation écologique…
Dans certains cas, le développeur devra racheter ou préserver une zone équivalente, mettre en œuvre un suivi biologique post-projet, ou réorienter le tracé du projet pour éviter les points sensibles. Tout cela alourdit le coût, les délais, et l’incertitude réglementaire. C’est pourquoi les développeurs procèdent à une analyse environnementale très tôt, souvent dès la signature de la promesse de bail.
Face à ces contraintes, il existe des marges d’adaptation. Un projet peut être redessiné pour éviter un bosquet, réduire sa surface, préserver un couloir écologique, ou intégrer un plan de compensation. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié.
Servitudes spécifiques et contraintes invisibles
Enfin, certains freins ne sont visibles ni sur le terrain, ni dans le PLU, mais apparaissent dans les bases réglementaires nationales. Il s’agit par exemple de :
la proximité d’un aérodrome, d’un site militaire ou d’une zone aéronautique : cela implique des contraintes de hauteur, voire une interdiction pure et simple
l’inscription dans le périmètre de protection d’un monument historique, soumis à l’avis des Architectes des Bâtiments de France (ABF)
l’exposition à un risque naturel majeur : inondation, feu, éboulement, zone Seveso, etc.
Ces servitudes peuvent bloquer un projet, imposer des études complémentaires, ou déclencher des refus inattendus en fin de parcours.
Raccordement au réseau : le critère qui rebat toutes les cartes

Un terrain peut réunir toutes les qualités : bien exposé, régulier, accessible, réglementairement compatible et pourtant, être écarté du radar des développeurs.
Pourquoi ? Parce que le raccordement au réseau électrique est souvent le facteur déterminant final : celui qui peut faire ou défaire un projet, même très bien conçu.
C’est l’un des premiers postes de coût variable pour un développeur, mais aussi une source majeure de délais, d’incertitudes techniques, et de dépendance à des tiers (Enedis, RTE, collectivités, propriétaires voisins). À ce titre, il est stratégiquement central.
Sans solution claire et viable de raccordement, aucun projet ne peut aboutir, quel que soit son intérêt technique ou foncier.
Une question de distance, de capacité et de concurrence
Quand un développeur évalue le potentiel d’un terrain, il cherche à savoir s’il pourra injecter l’électricité produite dans le réseau à un coût et dans un délai raisonnables. Il regarde d’abord trois éléments fondamentaux :
La distance entre le terrain et le poste source ou le point de raccordement : plus cette distance est longue, plus le coût de raccordement augmente.
La capacité disponible du poste source concerné : chaque poste a une limite de puissance qu’il peut accepter. Si le poste est saturé ou déjà réservé par d'autres projets, le terrain devient inexploitable à court ou moyen terme, sauf à financer son propre poste de raccordement ou attendre plusieurs années pour le renforcement du réseau actuel.
La file d’attente des projets en cours : même si un poste est ouvert “sur le papier”, il peut déjà être surchargé de demandes. Certains postes sont sollicités par 5, 10, parfois 20 projets en parallèle. Et comme l’ordre de traitement dépend souvent de la date de dépôt ou de la signature des conventions, arriver tard signifie parfois ne jamais passer.
Notre avis d'expert Ces trois paramètres sont croisés avec les données publiques disponibles (schémas régionaux S3REnR, publications d’Enedis ou RTE) mais surtout avec l’expérience terrain des développeurs. Ceux-ci savent où les délais s’allongent, où les coûts explosent, et où les opportunités sont réelles. |
Tracé du raccordement : un projet dans le projet

Le tracé du raccordement est un défi à part entière. Il ne suffit pas de sortir du terrain : il faut traverser plusieurs emprises, obtenir les autorisations nécessaires auprès de RTE, et parfois négocier ou imposer des servitudes.
Chaque mètre linéaire compte. En zone rurale, la ligne peut devoir traverser :
des terres agricoles ou boisées appartenant à des tiers,
des zones humides ou naturelles,
des voies publiques ou des cours d’eau.
Cela implique de nouvelles démarches : autorisations d’urbanisme, études d’impact, consultation des propriétaires concernés, voire recours à la déclaration d’utilité publique si aucune négociation amiable n’aboutit. Plus le tracé est long et complexe, plus le projet devient fragile.
Le réseau, une infrastructure mais aussi un facteur de hiérarchie entre projets
Ce que beaucoup de propriétaires ignorent, c’est que le réseau n’est pas neutre : il introduit une forme de concurrence silencieuse entre projets. Deux terrains équivalents techniquement n’auront pas du tout la même attractivité s’ils dépendent de postes différents.
Un projet très bien situé mais sur un poste saturé sera mis de côté. Un terrain moyen mais sur une zone réseau favorable sera étudié en priorité. Le raccordement devient donc un critère d’arbitrage stratégique, parfois plus décisif que la qualité foncière elle-même.
C’est pourquoi les développeurs font une analyse du réseau dès les premières phases. Certains disposent même de bases de données internes et de cartographies actualisées des capacités disponibles. Ce facteur, invisible pour le propriétaire, est souvent le déclencheur — ou le frein — principal. Pour plus d'informations sur le raccordement, cliquez ici.
Agrivoltaïsme et usage agricole : un cadre plus exigeant qu’il n’y paraît

La plupart des terrains disponibles en France sont situés en zone agricole. C’est donc tout à fait naturel que de nombreux propriétaires se demandent s’il est possible d’y implanter une centrale photovoltaïque. La réponse est oui — mais sous conditions strictes. Car aujourd’hui, un projet sur terre agricole doit s’inscrire dans le cadre de l’agrivoltaïsme, tel qu’il a été défini par la loi et précisé localement par les autorités agricoles.
Contrairement à une idée reçue, il ne suffit pas de “mettre des panneaux sur un champ”. L’agrivoltaïsme ne se limite pas à cohabiter avec l’agriculture : il doit démontrer qu’il maintient, améliore ou restaure la production agricole sur la durée, sans artificialiser les sols, ni concurrencer les usages agricoles prioritaires.
Pour en savoir plus sur l'agrivoltaïsme et la règlementation en vigueur, consultez notre article dédié.
L’usage réel du sol compte autant que son classement
Un point essentiel souvent méconnu : ce n’est pas uniquement la zone du PLU qui compte, mais aussi l’usage effectif du sol. Un terrain classé agricole (zone A) mais en friche totale depuis 20 ans ne sera pas perçu de la même manière qu’une parcelle en pâturage actif ou en grande culture.
Les développeurs et les autorités examinent donc :
le type d’exploitation en cours ou récente (pâturage, grandes cultures, arboriculture…),
la qualité agronomique du sol (données des chambres d’agriculture),
le potentiel de maintien d’une activité productive en parallèle du projet.
Plus le terrain est en activité réelle, plus l’acceptabilité sera élevée — à condition que le projet renforce ou préserve cette activité.
Notre avis d'expert De nombreux porteurs de projets sous-estiment la complexité du dossier agricole. Pourtant, c’est lui qui fait souvent la différence entre un projet accepté ou refusé. Il ne s’agit pas simplement d’annoncer qu’on mettra des moutons sous les panneaux : il faut un véritable plan de gestion agricole, argumenté, chiffré, parfois contractualisé avec un agriculteur partenaire. Ce travail est souvent fait en binôme entre le développeur et l'agriculteur en place. Pour le propriétaire, l’enjeu est de ne pas signer unilatéralement avec un acteur peu rigoureux sur ce volet, sous peine de voir son projet bloqué plusieurs années. |
Chartes départementales pour l’agrivoltaïsme : une grille de lecture locale souvent décisive
En parallèle du cadre national, de nombreux départements ont élaboré des chartes ou guides d’orientation sur l’agrivoltaïsme, à l’initiative des chambres d’agriculture, les syndicats et d’autres acteurs du territoire.
Ces documents n’ont pas de valeur réglementaire directe, mais ils constituent une base de lecture utilisée par les services instructeurs pour évaluer la recevabilité des projets. Ils précisent généralement :
les formes d’agrivoltaïsme considérées comme crédibles (pâturage sous structures fixes, maraîchage sous ombrières mobiles, arboriculture, etc.)
les structures techniques attendues (hauteur minimale, espacement, taux d’occupation du sol, mobilité des équipements…)
les exclusions de principe : surfaces maximales par exploitant, sols agricoles à haut potentiel, parcelles en friche sans activité avérée, projets sans portage agricole réel
les attendus en matière de dossier : diagnostic agronomique, plan de gestion, suivi technico-économique, convention avec un exploitant, etc.
Même sans valeur réglementaire, ces chartes ont un poids décisionnel fort : un projet non conforme à ces lignes directrices a peu de chances d’être autorisé, même s’il est techniquement viable.
Pour les développeurs sérieux, le respect de ces chartes est un prérequis incontournable. Pour les propriétaires, c’est un excellent point de départ pour comprendre ce qui est attendu localement et structurer leur démarche avec pertinence.
Documents-cadres pour l'agrivoltaïsme : une nouvelle boussole territoriale
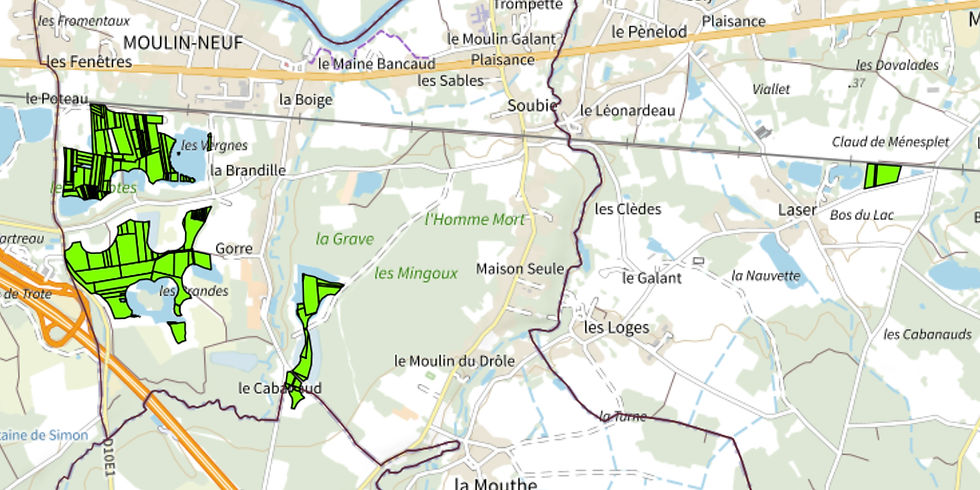
Depuis la loi Climat et Résilience, renforcée par la loi APER de 2023, le législateur a souhaité territorialiser davantage la planification énergétique. C’est dans ce contexte qu’ont été introduits les documents-cadres visés à l’article L. 111-29 du Code de l’urbanisme.
Dans le cas du photovoltaïque au sol, ces documents peuvent cibler certaines zones comme favorables ou prioritaires. Les terrains qui ne sont pas identifiés par ces documents-cadres ne pourront accueillir d'autres projets que des projets agrivoltaïques.
Pas encore tous publiés, à terme, ces documents-cadres seront un instrument incontournable lors de l’instruction des permis, et pourraient influencer fortement les décisions des services de l’État, notamment sur des projets complexes ou situés en zones agricoles.
Pour un propriétaire, cela signifie qu’un terrain bien placé dans le zonage d’un tel document peut bénéficier d’un accueil plus favorable. À l’inverse, un projet situé hors de ces orientations pourrait faire face à plus de scepticisme, voire à un refus administratif.
Une hiérarchie implicite des usages agricoles
Tous les usages agricoles ne se valent pas face à l’agrivoltaïsme. Les développeurs et les autorités appliquent une hiérarchie de fait, liée à la compatibilité entre l’activité agricole et la technologie photovoltaïque.
Voici une grille indicative des types d’usages les plus couramment jugés favorables ou défavorables :
Type d'usage | Acceptabilité |
Pâturage ovin extensif | très favorable. Les moutons cohabitent bien avec les structures, entretien naturel des parcelles, activité peu mécanisée. |
Cultures sous structures mobiles pilotées (maraîchage) | favorable sous réserve d’un projet bien conçu. |
Grande culture mécanisée (blé, maïs…) | complexe à intégrer, sauf avec structures très spécifiques (panneaux verticaux). |
Parcelles en friche, sans activité récente | très faible acceptabilité sans projet agricole solide. |
Foncier en AOC ou à haute valeur agronomique | souvent exclu, sauf exception localement défendue. |
Ces éléments sont étroitement liés aux situations départementales. Le projet doit être en cohérence avec les besoins de développement ou de soutien à certaines filières pour le département. Un projet bien monté techniquement, mais sur un terrain jugé “non prioritaire” ou mal justifié sur le plan agricole, sera probablement recalé.
Si votre terrain est éligible à un projet photovoltaïque : que se passe-t-il ensuite ?
Une fois qu’un terrain est jugé éligible, le projet passe d’une phase d’analyse à une phase d’engagement. Et ce basculement ne se fait jamais à la légère.
Ce qui suit est moins visible pour le propriétaire, mais c’est là que se joue la réussite du projet. Car même un terrain prometteur peut échouer faute de sécurisation juridique, de soutien local ou de planification réaliste. Voici les grandes étapes qu’un développeur sérieux anticipe dès que le terrain passe au vert.
1. Le foncier est-il sécurisable sur le long terme ?
Avant tout, il faut verrouiller la base du projet : l’accès au foncier. Cela passe par un bail emphytéotique (souvent entre 30 et 40 ans), ou parfois une convention d’occupation temporaire pour les biens du domaine public des collectivités. Le développeur devra aussi sécuriser :
les droits d’accès au chantier (voiries, emprises tierces),
les servitudes de passage pour les câbles de raccordement,
et parfois, des conditions particulières si le terrain est en indivision, en ZAC, sous SAFER ou propriété publique.
C’est à cette étape que le propriétaire doit être vigilant : ne pas signer trop tôt, ni avec le mauvais acteur, car les conditions fixées (durée, redevance, fiscalité, réversibilité) l’engagent sur plusieurs décennies.
Notre avis d’expert Le potentiel financier varie énormément : les loyers de fermes solaires peuvent atteindre 10 000 € par hectare et par an, notamment dans les zones fortement ensoleillées, mais nécessitent une négociation experte pour en maximiser la valeur. |
2. Le projet a-t-il une chance réaliste d’obtenir ses autorisations ?
Dès que le terrain est réservé, le développeur entame la vraie course de fond réglementaire. Il doit produire un dossier complet de permis de construire, comprenant une étude d’impact environnementale. Cette étude est lourde et coûteuse, car elle mobilise :
des relevés de terrain sur chaque saisons (faune, flore, sols, hydrologie),
des études paysagères, acoustiques, agricoles (si agrivoltaïsme),
un plan précis d’évitement, réduction et compensation des impacts.
Aussi, aucun projet ne réussit sans acceptabilité locale. Une opposition forte peut freiner, voire bloquer le processus. C’est pourquoi les développeurs se posent très tôt cette question : la commune soutiendra-t-elle le projet ? Les riverains seront-ils réceptifs ? Le projet s’intègre-t-il dans les démarches territoriales ?
Cela implique souvent, dès les premières étapes :
de présenter le projet à la mairie et à l’intercommunalité
de participer à des réunions de concertation
de s’inscrire dans les dynamiques locales : PCAET, ZAER, charte environnementale, etc.
d’ajuster le projet (paysage, pâturage, compensation locale) pour le rendre socialement acceptable
Un maire favorable et un bon ancrage local peuvent faire gagner un temps précieux. À l’inverse, une commune opposée, même sans base juridique solide, peut entraîner des retards importants.
3. Le projet tiendra-t-il ses promesses jusqu’au bout ?
Enfin, le développeur se projette : si le projet passe toutes les étapes, sera-t-il rentable sur 30 ans ? Le contexte réglementaire, fiscal, agricole ou social ne mettra-t-il pas en cause l’équilibre du montage ?
C’est pourquoi les projets sont modélisés dans le temps long, avec des hypothèses sur :
la production d’électricité (en lien avec l’ensoleillement réel, la configuration du site)
les charges d’entretien, les taxes, les obligations environnementales
les risques de contentieux ou de changement règlementaire



Commentaires