Centrales photovoltaïques et enjeux environnementaux
- vperrissin
- 21 août
- 8 min de lecture
Dernière mise à jour : 26 sept.
Alors que les énergies renouvelables gagnent du terrain, le photovoltaïque s’impose comme l’un des piliers de la transition énergétique en France.
Lors de son discours à Belfort le 10 février 2022, le Président de la République Emmanuel Macron annonçait un objectif de 100 GW de photovoltaïque pour 2050.
Les centrales photovoltaïques au sol représentent une partie importante de ce développement. Elles permettent notamment de produire à grande échelle une électricité décarbonée.
Mais son essor soulève aussi une question clé : où implanter ces centrales sans urbaniser le territoire à tout-va ?
Pour éviter une expansion aléatoire, le législateur a posé de nouveaux garde-fous pour protéger le territoire et limiter l’artificialisation des sols.
Le Code de l’urbanisme et le Code de l’environnement redessinent aujourd’hui la carte du solaire, en traçant les limites d’un secteur en pleine effervescence.
Ces réglementations, parfois perçues comme des obstacles, structurent en réalité la filière et favorisent l'émergence de projets plus solides, mieux intégrés et acceptés localement.

Identifier les enjeux environnementaux liés aux centrales photovoltaïques
Les centrales solaires au sol produisant plus d’1 MWc sont soumises à une évaluation environnementale.
Cet exercice constitue un véritable outil d’aide à la décision : il permet d’intégrer, dès la phase de conception, les enjeux environnementaux et sanitaires dans les projets d’aménagement, d’infrastructures ou d’activités, mais aussi dans les plans et programmes. L’objectif principal est d’anticiper et de limiter les impacts négatifs sur l’environnement, en les identifiant en amont et en adaptant le projet en conséquence.
Cette étape est longue et coûteuse, mais elle permet de vérifier la compatibilité du projet avec son environnement.
Si votre projet photovoltaïque est soumis à une évaluation environnementale, il sera indispensable de faire appel à un bureau d’études spécialisé pour réaliser une étude d’impact.
Cette étude comprend notamment un inventaire faune-flore, visant à identifier les espèces animales et végétales protégées présentes sur le site. Pour garantir la fiabilité des résultats, les campagnes d’inventaires doivent s’étendre sur une année complète, afin de couvrir l’ensemble des cycles biologiques.
Le décret n°2025-804 du 11 août 2025 fixe une durée de validité de 5 ans des inventaires de biodiversité pour l'état initial et les incidences du projet. Cette durée s'apprécie à la date de dépôt du dossier de demande de l'autorisation.
Espèces protégées et habitats naturels
En matière de biodiversité, la loi ne distingue pas entre habitats naturels et habitats artificiels. Ainsi, même une carrière, une friche industrielle ou un plan d’eau artificiel peut être considéré comme un habitat d’espèces protégées, dès lors que celles-ci y sont présentes.
Le Code de l’environnement (articles L.411-1 et L.411-2) pose un principe clair :
il est interdit de détruire, altérer ou perturber les espèces protégées et leurs habitats,
cette interdiction s’applique en tout temps et en tout lieu.
Cependant, la réglementation prévoit une possibilité de dérogation, à condition de répondre à trois critères cumulatifs :
Pas d’alternative satisfaisante au projet envisagé ;
Motif d’intérêt public majeur (sécurité, santé, projet économique ou social important) ;
Garantie du maintien dans un état de conservation favorable des populations d’espèces concernées.
En pratique, cela signifie que si un terrain, même artificiel, abrite des espèces protégées (oiseaux, chauves-souris, amphibiens, flore…), tout projet d’aménagement nécessitera une demande de dérogation "espèces protégées". Cette demande est instruite par la DREAL, avec l’avis soit du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) soit du Conseil National de Protection de la Nature.
En intégrant dès le départ les enjeux de biodiversité, votre projet gagne en crédibilité, en légitimité et en attractivité. Connaître et mobiliser les leviers réglementaires existants, c’est transformer une contrainte en opportunité pour accélérer et sécuriser vos projets.
Les leviers réglementaires pour mener à bien les projets
La séquence ERC : Éviter, Réduire, Compenser
L’application de mesures ERC (Éviter, Réduire, Compenser), mises en place par la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de l'environnement, constitue un levier essentiel pour justifier l’obtention d’une dérogation tout en protégeant l’environnement.
La phase « Éviter » vise à adapter le projet afin de supprimer en amont ses impacts sur l’environnement.
La phase « Réduire » a pour objectif de limiter l’intensité, la durée ou l’étendue des impacts qui n’ont pas pu être évités.
La phase « Compenser » consiste à mettre en place des actions apportant une contrepartie équivalente aux effets négatifs résiduels du projet sur l’environnement.
L’ordre de cette séquence reflète une hiérarchie : l’évitement doit être privilégié, car il constitue la seule garantie d’absence d’atteinte à l’environnement concerné. La compensation, quant à elle, ne doit être envisagée qu’en ultime recours, lorsque les impacts n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.
La séquence ERC concerne les projets photovoltaïques soumis à une autorisation administrative au titre du code de l’environnement (autorisation environnementale, dérogation relative aux espèces protégées, évaluation des incidences Natura 2000, etc.).
Si cet outil fixe un cadre clair pour concilier aménagement et préservation de la biodiversité, de nouveaux outils permettent aujourd’hui de renforcer et d'accélérer la transition énergétique.
Les zones d'accélération de la production d'énergie renouvelable

La loi du 10 mars 2023 "APER" a sollicité les communes pour identifier sur tout le territoire des zones d’accélération de la production d'énergie renouvelable (ZAER).
C'est un véritable levier pour simplifier et sécuriser le développement de vos projets photovoltaïques. Cette cartographie met en valeur les zones les plus favorables, tout en associant étroitement les acteurs locaux.
Résultat : une implantation mieux intégrée, plus durable et plus facile à défendre auprès des parties prenantes.
Installer une centrale solaire dans une ZAER, c’est bénéficier d’avantages concrets :
Des délais d’instruction réduits de 6 mois,
Une acceptabilité locale renforcée,
Une meilleure visibilité dans les appels d’offres de la CRE.
En d’autres termes, développer une centrale solaire dans une ZAER, c’est opter pour un gain de temps certain, une meilleure faisabilité et une réduction des risques pour votre projet. Un atout stratégique qui fait la différence entre un projet solaire simplement envisageable… et un projet solaire réellement réalisable.
Un délai d’instruction encadré pour vos projets
La directive européenne "RED III" pour la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables de 2023 apporte une avancée majeure pour les porteurs de projets. Elle fixe désormais un délai maximum d’instruction pour les demandes de permis de construire.
Concrètement, tout projet situé en ZAER bénéficie d’une procédure strictement limitée à 12 mois.
Pour les projets situés en dehors des ZAER, la durée maximale d’instruction des demandes de permis est de 24 mois.
Un cadre clair, sécurisé et prévisible qui permet d’accélérer la mise en œuvre de vos centrales solaires tout en renforçant la confiance des investisseurs et des collectivités.
Toutefois, la France n’a pas encore transposé cette directive. Le 26 septembre 2024, la Commission européenne a adressé à la France une lettre de mise en demeure pour défaut de transposition complète dans son droit national.
Pour développer votre centrale photovoltaïque dans le respect du droit de l'environnement, il est indispensable de cibler les zones propices à cette activité.
Identifier le foncier disponible
Des zones à fort enjeu environnemental
Certaines zones sont à éviter de tout projet photovoltaïque afin de préserver la biodiversité, le patrimoine naturel ou la sécurité des personnes :
Les ZNIEFF de type 1 (zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique),
Les arrêtés de protection des biotopes,
Les espaces boisés classés,
Le cœur des parcs nationaux,
Les réserves biologiques de l’ONF,
Les forêts labellisées d’exception,
Les forêts de protection,
Les réserves naturelles,
Les éléments de la trame verte identifiés dans les documents d’urbanisme,
Les zones à risque d’inondation où le règlement du PPRI interdit l’installation de panneaux photovoltaïques,
Les sites classés au titre du patrimoine naturel ou culturel.
Identifier ces zones en amont est essentiel pour sécuriser votre projet, éviter des refus administratifs et cibler des sites réellement exploitables pour le développement de centrales solaires.
Compatibilité avec l’urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), ou à défaut la carte communale, constitue la première source d’information pour savoir où implanter un projet photovoltaïque. Il définit l’usage autorisé du sol et délimite les zones constructibles ou protégées.
Chaque PLU inclut non seulement un zonage, mais également un règlement écrit qui précise ce qui est permis ou interdit dans chaque zone : taille maximale des projets, exigences en matière d’intégration paysagère, conditions de raccordement, et autres contraintes spécifiques.
Notre avis d'expert Un terrain peut théoriquement être adapté à un projet solaire, mais être interdit par le PLU. À l’inverse, certains PLU autorisent les projets sous certaines conditions. Chaque commune définit son propre cadre, ce qui rend l’analyse locale indispensable pour sécuriser un projet. Chez Solaire Conseil, nous veillons à la viabilité de votre projet en optimisant les conditions d’implantation de vos installations photovoltaïques. |
Objectif de sobriété foncière
Depuis la loi Climat et Résilience, la France s’est fixée des objectifs ambitieux pour préserver ses espaces naturels, agricoles et forestiers. D’ici 2030, la consommation de ces sols devra être réduite de moitié par rapport à la période 2011-2021.
À plus long terme, l’objectif est d’atteindre la « zéro artificialisation nette » (ZAN) à l’horizon 2050. Concrètement, cela signifie que toute nouvelle artificialisation devra être compensée par une restauration équivalente des sols, afin de protéger durablement l’environnement tout en permettant un développement réfléchi des projets, y compris dans le secteur photovoltaïque.
Cette nouvelle réglementation pousse le secteur du photovoltaïque à innover pour installer des centrales solaires en conformité avec le droit.
Des contraintes qui transforment la filière
Les terres agricoles, forestières ou naturelles sont de plus en plus difficiles à mobiliser. L’État oriente désormais le développement vers des terrains déjà artificialisés : friches, anciennes carrières, parkings, décharges, zones industrielles désaffectées.

Implanter une centrale solaire sur un site à moindre enjeu foncier représente une opportunité unique : transformer un espace dégradé en un outil de production d’énergie renouvelable.
Ce choix présente de multiples avantages :
Donner une nouvelle vie à un site inutilisé ou abîmé,
Bénéficier de conditions tarifaires avantageuses,
Préserver les sols agricoles et naturels, en limitant la consommation d’espaces sensibles,
Soutenir concrètement la transition énergétique au niveau local, avec des retombées positives pour le territoire.
Ces projets solaires sont la preuve qu’il est possible d’allier valorisation foncière, performance énergétique et respect de l’environnement. Ces efforts se concentrent dès les choix des terrains mais se poursuivent également jusqu'à l'organisation de la filière de recyclage des panneaux.
Notre avis d'expert Un projet bien pensé, concerté avec les habitants et respectueux du territoire a beaucoup plus de chances d’être accepté. Les collectivités y trouvent une source de revenus (loyers, fiscalité) et une image positive en matière de transition énergétique. Plusieurs communes françaises ont transformé des décharges municipales en centrales solaires. Résultat : un site réhabilité, une énergie locale produite, et une fierté partagée avec les habitants. |
Les enjeux à surveiller
Malgré ces avancées, certains débats restent vifs.
Conciliation entre énergie et alimentation : L’usage des terres agricoles reste sensible. L’agrivoltaïsme apparaît comme une solution, mais il doit rester complémentaire, pas concurrent de la production alimentaire. Retrouvez dans notre article dédié toutes les clés pour comprendre l’agrivoltaïsme et sa réglementation.

Préservation de la biodiversité : Les friches industrielles sont intéressantes, mais elles peuvent abriter des espèces rares. L’étude d’impact doit être rigoureuse pour ne pas déplacer les problèmes.
Équilibre entre petits et grands projet : Il est aussi aussi possible de soutenir les installations locales en l’autoconsommation collective.
Compétitivité : Les contraintes françaises rendent les projets plus longs et plus coûteux que dans d’autres pays. Mais cette exigence de qualité pourrait devenir un atout sur le long terme, en garantissant des projets robustes et durables.
Notre avis d'expert En conciliant transition énergétique et protection des enjeux environnementaux, la France construit un modèle de centrales photovoltaïques au sol plus responsable, plus accepté et plus pérenne. Le solaire au sol a un potentiel considérable, mais il doit être pensé autrement. La règle aujourd’hui est claire : pas de projets « contre » l’environnement ou « contre » les territoires. Les projets de demain seront ceux qui sauront :
|


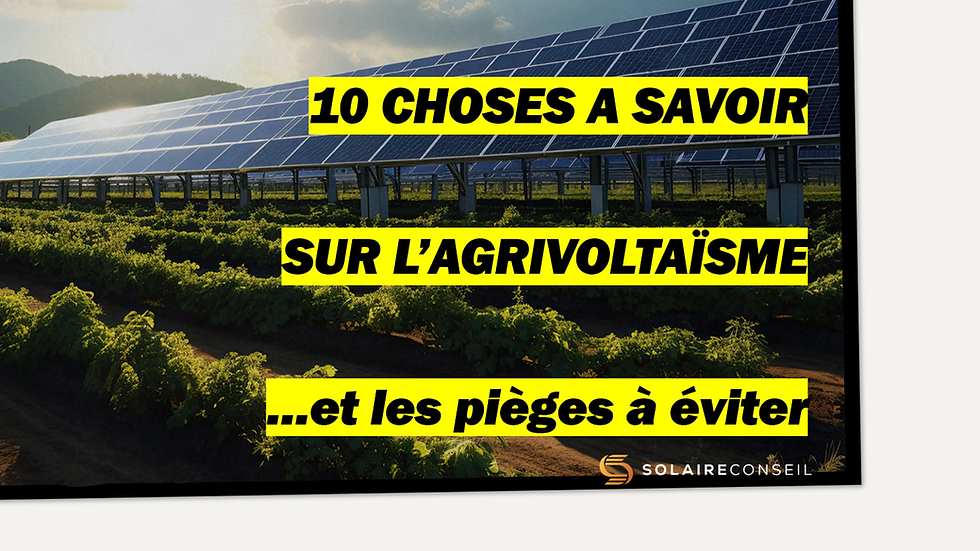
Commentaires